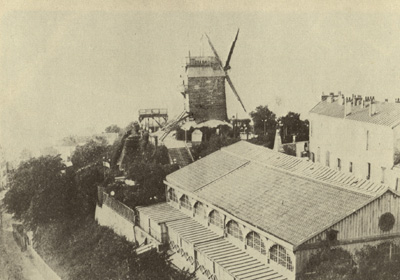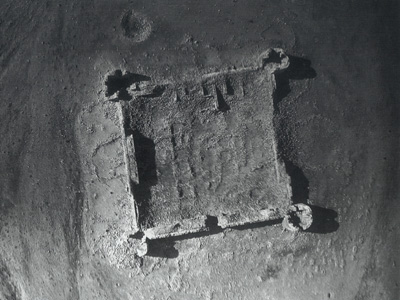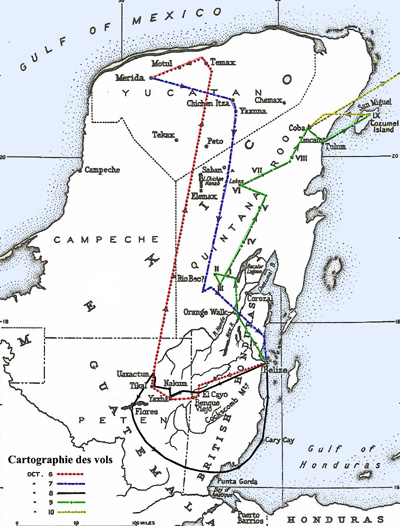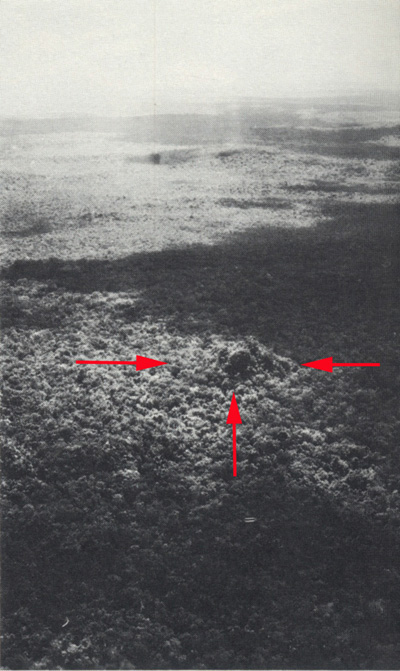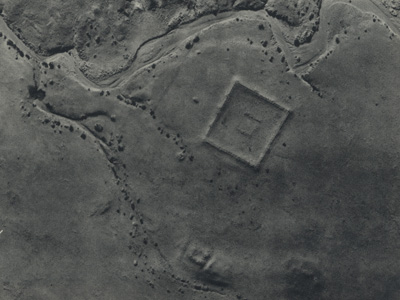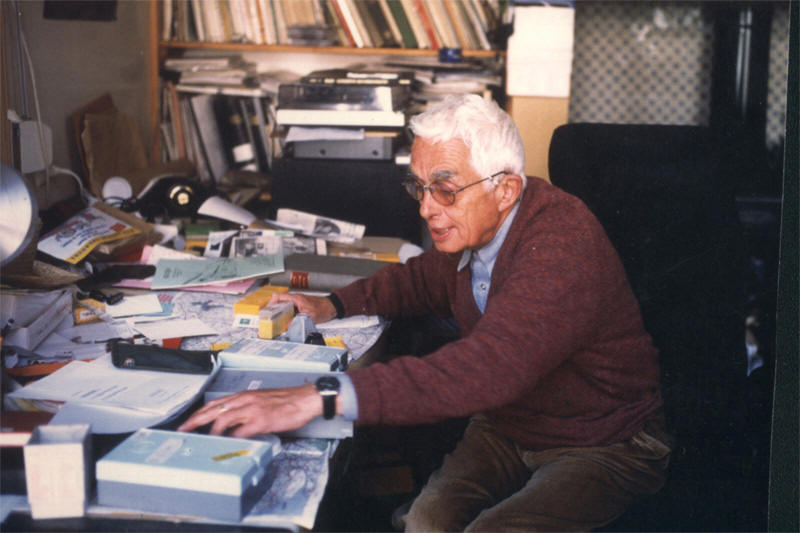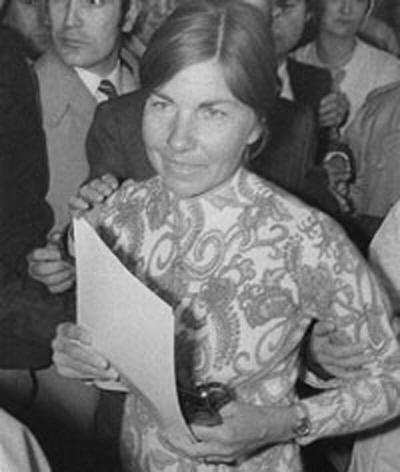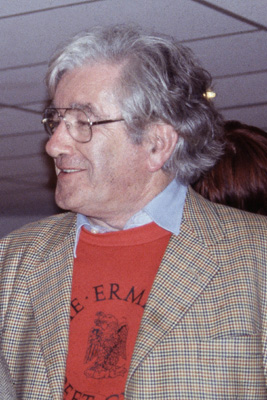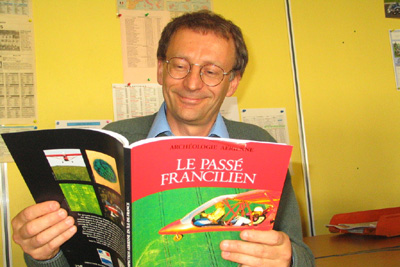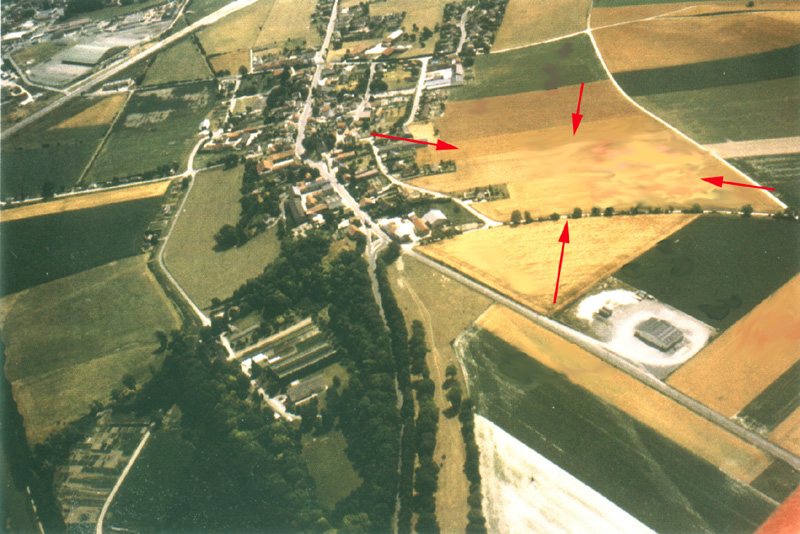| |
|
|
| |
Un peu d'histoire
... |
|
| |
|
|
| |
è
Bien avant l'invention de l'avion |
|
| |
è
Nadar, alias
Félix TOURNACHON |
|
| |
è
Des débuts difficiles |
|
| |
è
Révérend Père
POIDEBARD |
|
| |
è
Charles
LINDBERGH |
|
| |
è
Maria REICHE |
|
| |
è
Géoglyphes de la Nazca |
|
| |
è
Colonel BARADEZ |
|
| |
è
La recherche en Europe |
|
| |
è
Les faucheurs de marguerites |
|
| |
è
L'émergence d'une discipline |
|
| |
è
Osbert Guy Stanhope CRAWFORD |
|
| |
è
John Kennet Sinclair SAINT-JOSEPH |
|
| |
è
Irwin SCOLLAR |
|
| |
è
Otto BRAASCH |
|
| |
è
Roger AGACHE |
|
| |
è
Raymond CHEVALLIER |
|
| |
è
Françoise CLAUSTRE |
|
| |
è
Maurice
MARSAC |
|
| |
è
Daniel JALMAIN |
|
| |
è
René GOGUEY |
|
| |
è
Jean ROISEUX |
|
| |
è
Louis MONGUILAN |
|
| |
è
Charles LEVA,
Henri DELETANG et Michel DRILEN |
|
| |
è
Maurice GAUTHIER |
|
| |
è
Marc LANGLOIS et Pascal LAFOREST |
|
| |
è
François BESSE |
|
| |
è
Patrick F. JOY |
|
| |
è
Bernard LAMBOT |
|
| |
è
François VASSELLE |
|
| |
|
|
| |
 Bibliographie sommaire
Bibliographie sommaire |
|
| |
|
|
| |
|
|
 |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 Bien avant l'invention de l'avion
Bien avant l'invention de l'avion |
|
| |
|
|
| |
Bien avant la photographie
aérienne, certains chercheurs avaient remarqué qu'à l'emplacement des
vestiges enfouis, il pouvait y avoir variation de teinte des sols et des
cultures.
Des phénomènes révélateurs de vestiges enfouis sont déjà mentionnés en
France dans des publications à partir du XVIIeme siècle : description
d'anomalies spécifiques révélant d'anciennes occupations humaines dans
les landes et dans les zones non cultivées, qu'il s'agisse de taches
d'humidité différentielles sur sols nus ou d'anomalies de la croissance
des céréales.
Ainsi, dans son "Histoire et antiquitez du pays de Beauvaisis"
paru en 1631, Louvet parle-t-il en ces termes de l'emplacement d'une
villa romaine arasée à Vendeuil-Caply (Oise) :
"Quand cette campagne est ensemencée de
bled, on y reconnoît encore le compassement et les endroits des rues où
le bled est plus petit qu'es lieu où les maisons étaient bâties".
Il paraît évident que l'archéologie aérienne a pu
naître seulement après que l'homme ait inventé les moyens de s'élever
dans les airs et de s'y déplacer selon sa volonté. Les premières
montgolfières remontent à 1783 et l'avion aux environs de 1900. En fait
la vision aérienne ne deviendra une souce d'informations scientifiques
qu'à partir du moment où il sera également possible de fixer les images.
|
|
| |
|
|
| |
 Nadar, alias Félix Tournachon
Nadar, alias Félix Tournachon |
|
| |
|
| |
 |
On doit attendre que Félix Tournachon, dit Nadar, après
plusieurs essais infructueux, réussisse en Octobre 1858 sa première
photographie aérienne à 80m au dessus du Petit-Clamart, dans la banlieue
parisienne. |
|
| |
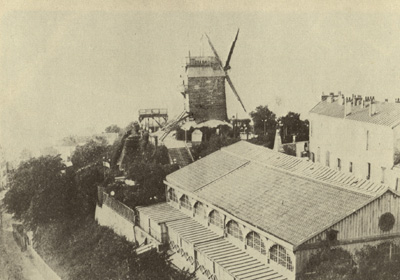 |
Ce moulin, immortalisé par Nadar, fût détruit
dans les années 1960. |
|
| |
|
|
| |
 Des débuts difficiles
Des débuts difficiles |
|
| |
|
|
| |
C'est en 1929 que commencèrent en
Amérique les prospections rendues célèbres en 1927 par la traversée de
l'Atlantique, Charles A. Lindberg. Il a notamment obtenu de bons
résultats en survolant les zones tropicales et équatoriales, en Amérique
centrale, à la recherche de Mayas.
En Europe, dès le début du XXème siècle, on prend des photographies
aériennes à l'aide d'un ballon, comme à Stonhenge en Grande-Bretagne, à
Rome et à Ostie en Italie. Pendant la première guerre mondiale de
1914-1918, la photographie aérienne va être systématiquement utilisée
pour guider les opérations des troupes au sol et l'aviation. C'est
principalement sur les confins de la Méditerranée orientale, dans les
régions désertiques et sub-désertiques, que, d'emblée, des résultats
positifs furent obtenus par les militaires.
|
|
| |
|
|
| |
 Révérend père Poidebard
Révérend père Poidebard |
| |
|
| |
 |
D'extraordinaires clichés sont pris par le
révérend père Poidebard de 1925 à 1942 en Syrie lorsqu'il étudie le
limes romain, la ville de Tyr et son port submergé et le limès byzantin
de Chalcis. Ses clichés, parus dans l'illustration, lui valent une
notoriété malgré l'ironie de certains savants qui, au début, le
considéraient comme un fantaisiste à la Jules Verne. |
|
| |
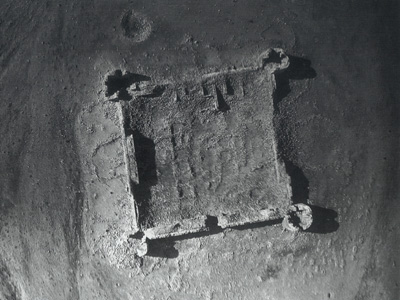 |
Fortin romain de Khan el-Hallabat (Bériarca,
vers 300 après J.C.) au Sud-Ouest de Palmyre, sur la strata diocletania. |
|
| |
|
|
| |
 Charles LINDBERGH
Charles LINDBERGH |
|
| |
|
|
| |
 |
Colonel
Charles Lindbergh photographié devant son « Spirit of St Louis », en
1927, au U.S.A. avant son envol du 21 mai pour l’exploit qui le rendra
célèbre.
Peu ou pas d’archéologues savent que l’aviateur a fait des recherches
de prospection aérienne. |
|
| |
 |
Charles Lindbergh
et son épouse Anne Spencer Morrow lors de leur voyage d'étude
archéologique sur les indiens Pueblo dans le sud-ouest des Etats-Unis.
Anne était la fille de l'ambassadeur américain au Mexique que Lindbergh
rencontra lors d'un voyage d'étude en 1927. Les époux Lindbergh firent
un vol de recherches sur la civilisation Maya sur le Yucatan, les
6,7,8,9 et 10 octobre 1929.
|
|
| |
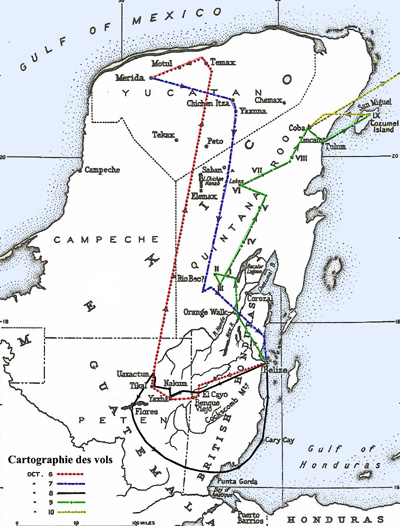 |
Carte de cinq
survols d'octobre 1929 sur les territoires Maya dans la péninsule du
Yucatán effectués par le couple Lindbergh.
|
|
| |
 |
L'équipage de
jeunes mariés découvrit, entre autres, deux chaussées surélevées maya au
sud de Cobá, Anne étant la photographe.
|
|
| |
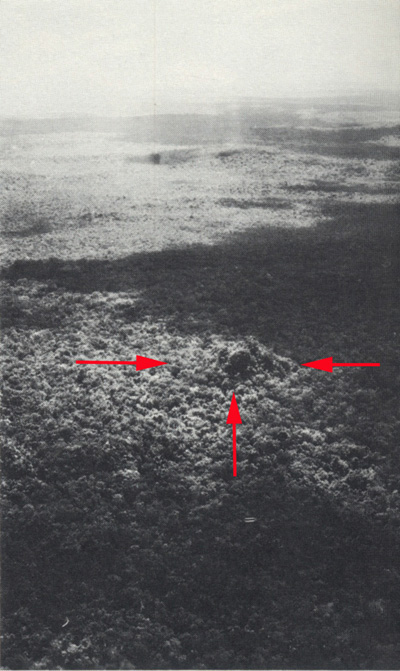 |
Le même équipage
identifie des ruines précolombiennes inconnues formant des proéminences
sous le couvert de l'immense jungle guatémaltèque au nord de Petén.
|
|
| |
|
|
| |
 Maria REICHE
Maria REICHE |
|
| |
|
|
| |
Cette mathématicienne allemande,
dont le nom est indissociable des lignes de Nazca, est née à Dresde en
1903. Elle arriva au Pérou en 1932 et travailla pour le consulat
allemand à Cuzco. Elle devint, sept ans plus tard, l'assistance de Paul
Kosok, anthropologue américain avec qui elle survole pour la première
fois les mystérieuses traces de la vallée d'Ica. Passionnée par ces
lignes, elle s'y consacra corps et âme pendant trente années de sa vie.
Elle tenta d'expliquer que ces lignes sont en corrélation avec la
position de certaines étoiles et qu'elles représentent une sorte de
calendrier astrologique.
|
|
| |
 |
A partir de 1941, elle loue une
cabane tout près de la vallée et commence son travail d'observation et
de mesure. Dès l'aude elle se rend dans le désert pour assister au lever
du soleil. Puis munie d'un peu d'eau, de quelques fruits et de son
matériel de dessin, elle arpente les lieux en solitaire, toute la
journée durant. En 1949, elle révèle au
monde entier les lignes de Nazca en publiant "Mystères du désert". Son
obsession la pousse à nettoyer scrupuleusement les lignes pour leur
rendre leur splendeur et à se déplacer sur des planchettes pour ne pas
piétiner ses chers sujets d'étude alors que d'autres roulent dessus sans
vergogne.
ç Maria Reiche,
en 1960 |
|
| |
 |
A Nazca, la tombe de Maria Reiche, décédée en 1998 à
l'âge de 95 ans, est ornée des géoglyphes qu'elle aimait tant. A 90 ans,
celle qui n'a jamais voulu quitter le Pérou répondait à sa famille qui
la priait de rentrer en Allemagne : " J'ai encore tant à faire dans la
pampa de Nazca".
ç Maria Reiche,
en 1985
|
|
| |
|
|
| |
 Clichés des géoglyphes de la Nazca
Clichés des géoglyphes de la Nazca |
|
| |
|
|
| |
 |
Pérou (Amérique latine)
Clichés
des géoglyphes de la Nazca. La première description date de 1551, par
l'espagnol Cierza de León dans sa Chronique du Pérou. En
septembre 1926 deux archéologues (l'Américain Alfred Kroeber et le
Péruvien Mejia Xesspe) gravissent une colline dominant la vallée de
Nazca et aperçoivent de longues lignes qui s'entrecroisent sur le
plateau. Cette découverte n'est confirmée qu'en 1939 avec la prise de
photographies aériennes par Paul Kosok de l'Université de Long Island
(New York). Ensuite, une mathématicienne allemande, Maria Reiche
consacra sa vie à l'étude et la préservation de ces figures. Ces figures
sont visibles d'avion sur près de 400 km2 pour toute personne qui veut
se donner la peine de payer un pilote de Cessna péruvien. Ces images
sont représentatives de l'esprit d'un peuple dont la civilisation
s'étagea de - 500 à + 500 sur ces terres arides. Il faut remarquer que
chaque dessin est figuré par un seul "fil", qui ne se croise pas, donc
basé sur le principe du labyrinthe. |
|
| |
 |
|
| |
 |
|
| |
|
|
|
| |
|
| |
 Colonel J. Baradez
Colonel J. Baradez |
| |
|
| |
 |
 |
|
| |
 |
Clichés originaux du neveu du colonel
Baradez 1 : 1917 - Le colonel
Baradez a terminé la Grande guerre comme lieutenant-observateur
aérostier.
2 : Le colonel Baradez, en toge lorsqu'il fut nommé docteur
honoris causa de l'université de Durham (Grande-Bretagne) en 1954.
3 : Le colonel Baradez, deux ans avant se disparition. |
|
| |
Après la seconde
guerre mondiale, un autre français, le colonel J. Baradez publiait en
1949 un important volume de photographies aériennes prises avec un
éclairage rasant par l'armée. Il condamne sévèrement les prises de vues
obliques et préconise le recours exclusif aux couvertures aériennes :
"hors du stéréoscope, pas de salut!" disait-il. |
| |
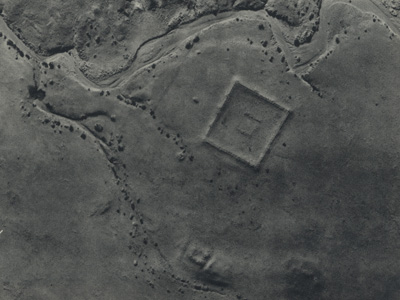 |
Grand fort romain datant probablement de
Gordien III (238-244), découvert en B26 Marauder, le 14 février 1947. |
|
| |
|
|
| |
 La recherche en Europe
La recherche en Europe |
|
| |
|
|
| |
En Grande-Bretagne, O.G.S.
Crawford est le premier, en 1922, à avoir détecté des sites
archéologiques totalement nivelés des les régions où l'agriculture
généralisée rend les repérages plus difficiles. A l'aide d'un collègue
qui finança cette première prospection systématique dans le Wessex, ce
chercheur anglais publia un livre fondamental pour l'histoire de cette
discipline (Craword et Keller, 1928) puis un autre très spectaculaire en
1929.
Ce fut la stupéfaction générale et un grand enthousiasme devant cette
révélation inespérée des "Ghosts of Wessex", ces fantômes du passé. Les
plus remarquables clichés ont été réalisés par le professeur John
Kenneth Saint-Joseph à partir de 1939. Après la guerre, il continue à
voler avec des avions de la RAF. Puis à bord d'un avion de l'université
de Cambridge spécialement équipé, et avec un pilote très entraîné,
Saint-Jospeh prit lui-même de 1966 à 1980 des centaines de milliers de
grands clichés grand format en noir & blanc. Il ne s'est pas contenté
d'être seulement un archéologue volant, il photographia et étudia tout
ce qui d'avion pouvait avoir un intérêt dans les domaines scientifiques
les plus variés. Il se spécialisa dans la fouille de camps romains.
En Allemagne, les recherches ont été entreprises, à partir de 1960, par
Irwin Scollar, puis par Otto Braasch. En Belgique en 1965 par Charles
Léva. Ce dernier a crée, avec des moyens personnels, un important
centre interdisciplinaire de recherches aériennes (CIRA).
|
|
| |
|
|
| |
 Les "faucheurs de marguerites"
Les "faucheurs de marguerites" |
|
| |
|
|
| |
De 1952 à 1962, une première
génération de pionniers publièrent des clichés révélateurs de l'intérêt
de la prospection aérienne pour l'archéologie. Citons Bernard Parruzot,
René Dielh, Roger Chevallier, Bernard Chertier, Robert Ertlé, Daniel
Jalmain, René Goguey et Roger Agache.
Leurs appareils photographiques de "premiers communiants" et leur
"trottinettes" d'aéroclubs faisaient sourire les militaires qui
disposaient de gros moyens techniques. Comme la plupart des
spécialistes, il ne juraient que par les couvertures aériennes à haute
altitude. Nombre d'universitaires étaient aussi incrédules car il
estimaient que c'était trop beau pour être vrai. Toutefois, ce fut un
colloque international d'archéologie aérienne, organisé à Paris en 1963
par le professseur Chevallier qui marqua une étape décisive en France
mais aussi à l'étranger. On prit alors véritablement conscience de
l'intérêt des résultats déjà obtenus avec des moyens ridicules.
|
|
| |
|
|
| |
 L'émergence d'une discipline
L'émergence d'une discipline |
|
| |
|
|
| |
La Somme fut présentée à ce
colloque comme le département pilote de l'archéologie aérienne en
France. D'une part, Roger Agache avait publié la première synthèse
régionale en ce domaine avec 93 illustrations dès 1962. Cette brochure
fut largement diffusée en France et à l'étranger. D'autre part les
résultats y étaient particulièrement spectaculaires. Le succès de ces
manifestations et la poursuite de l'enseignement à l'Ecole Pratique des
Hautes Etudes firent qu'une deuxième génération de prospecteurs à basse
altitude se manifestèrent dans les années qui suivirent. Citons entre
autres : Michel Boureux, François Vasselle, Jacques Dassié et le colonel
Louis Montguilan.
Actuellement, il faut compter près de quatre-vingts archéologues dont
beaucoup d'amateurs qui pratiquent régulièrement l'archéologie aérienne
un peu partout en France, sous le contrôle du Ministère de la Culture
(Service régionaux de l'Archéologie des DRAC), avec l'aide financière de
l'état, des collectivités et d'associations. Il est impossible de les
citer tous, mais l'un d'entre eux, Gérard Chouquer en renouvelle la
méthodologie, surtout pour l'étude des paysages. De remarquables clichés
ont été publiés, entre autres par Bernard Lambot, Maurice Marsac,
Jean-Paul Petit, Henri Delétang, Jean Desloges, Annie Etienne, Patrick
Péridy, Alain Lelong, Jacques Dubois, Jean Holmgren, Claude Leymarios,
Loïc Langouët, Michel Loiseau, Jean-Paul Delor, Jacques Meissonier,
Christian Richard, Patrick Joy, Jean Roiseux, François Besse, Françoise
Claustre et jean Vaquer...Mais le plus
étonnant est qu'une région, apparemment aussi peu prometteuse que la
Bretagne, ait pu donner autant d'excellents résultats, remarquablement
publiés par Gilles Leroux, Maurice Gautier, Jean-Claude Meuret et
Patrick Naas (1999).
|
|
| |
|
|
| |
 Osbert Guy Stanhope CRAWFORD
Osbert Guy Stanhope CRAWFORD |
|
| |
Né le 28 octobre1886 à Bombay et
décédé le 28 novembre 1957; O.G.S. Crawford était un archéologue anglais
et le pionnier de l'utilisation de clichés aériens pour approfondir
l'interprétation archéologique du paysage.
Après la mort de sa mère en 1886 et de son père en 1894 il fut élevé par
ses tantes maternelles. Il fit ses études au Marlborough College puis au
Keble College, à Oxford. Pendant la première guerre mondiale, il a
d'abord servi dans les "London scottish", puis dans la division
d'observation de la troisième armée. A partir de 1917 il a été
observateur dans la Royal flying Corps. Son avion a été abattu en 1918
et il a été retenu prisonnier à Holzminden jusqu'à la fin de la guerre.
|
|
| |
 |
Après une série d'activités de
courtes durée, il fût nommé premier officier archéologue de l'équivalent
anglais de notre Institut Géographique National en 1920. Poste qu'il
conserva jusqu'à son départ en retraite en 1946.
En 1927, il fonda "ANTIQUITY" (Antiquité), une revue archéologique
trimestrielle. |
|
| |
Pendant la seconde guerre mondiale, il a eu en
charge la responsabilité de sauver une grande quantité de mobilier
historique, dans son propre garage à Nursling, lorsque les bureaux de
l'Institut géographique de Southampton furent ravagés par un incendie,
suite à un bombardement.
|
|
| |
|
|
| |
 John Kenneth Sinclair SAINT-JOSEPH (1912-1994)
John Kenneth Sinclair SAINT-JOSEPH (1912-1994) |
|
| |
Kenneth Saint-Joseph développa la
science de la photographie aérienne pour la recherche scientifique en
Grande-Bretagne. Elle fit des avancées énormes dans le développement de
la géologie moderne, la pédologie, la géographie et, surtout, en
archéologie aérienne de l'époque préhistorique jusqu'à l'époque
médiévale.
En 1939, il enseignait la géologie à l'Université de Cambridge et à
Selwyn College où il avait été étudiant.
Ce qui changea totalement la direction de sa vie fut son service dans la
Royal Air Force pendant la seconde guerre mondiale. Dans l'Intelligence
Service, on découvrit chez lui des yeux d'aigle, une vue perçante qui
lui donna un talent spécial dans l'interprétation des photos aériennes.
Son service dans l'aviation l'avait appris à connaître le rôle des
caméras dans les avions de chasse. St Jospeh se rendit compte combien
cette nouvelle technique serait utile, après la guerre, dans les études
scientifiques.
|
|
| |
A son retour à Cambridge en 1945,
toujours comme maître de conférence en géologie, Saint-Joseph entreprit
la tâche de persuader l'Université de créer un département nouveau de
photographie aérienne. En général, on considère comme impossible de
tirer des fonds d'une corporation universitaire pour fonder une
entreprise nouvelle puisque celle-ci oblige oblige à retirer de l'argent
de quelques projets qui existent déjà. En apparence, St Joseph n'était
pas doué pour la persuasion, mais ce qui le motivait était sa ténacité
tranquille et modeste, une confiance totale dans l'avenir de sa cause
ainsi que l'appui de plusieurs savants éminents. La RAF l'aida encore en
fermant l'oeil sous prétexte que, puisque les vols seraient effectués
pendant les exercices d'entraînement; l'Université n'aurait pas à
rembourser l'essence, ni le coût des avions. |
 |
|
| |
Tout d'abord, sa collection
de photo, dont il était le conservateur, fut abritée dans une pièce
minuscule. Par la suite les photos on été transférées dans un vaste
maison particulière et finalement dans une partie du Laboratoire
historique Mond. St Joseph devint alors professeur et directeur de l'une
des plus prestigieuses collections de photographies aériennes du monde
entier. |
|
| |
L'avance la plus importante fut en
archéologie romaine. Les travaux de St-Joseph ont fourni de nouvelles
connaissances sur la Grande-Bretagne romaine et surtout sur l'Ecosse.
Ont découvrit plus de 200 nouveaux forts et de nouvelles fouilles,
prometteuse de résultats, furent entreprises.
Il était souvent consulté par les commissions officielles du
gouvernement ou des ministères au sujet des monuments historiques, des
fôrets, de l'environnement et de sa conservation, de l'agriculture et de
la science des sols. |
 |
|
| |
|
|
| |
 Irwin SCOLLAR
Irwin SCOLLAR |
|
| |
Né le 13 novembre 1928 à New-York.
Diplômé de la Bronx High School of Science en 1945 il a obtenu une
licence d'Art à l'université de Lehigh à Bethlehem (Pennsylvanie) en
1951 et étudia comme matière secondaire l'archéologie et l'histoire de
l'Art. De 1948 à 1952 il a travaillé comme ingénieur pour le déploiement
du réseau de diffusion de la télévision en couleur de la NBC (filiale de
RCA). |
|
| |
De 1953 à 1954 il a obtenu une
bourse universitaire par le "Metropolitan Museum of Art" de New-York.
Ensuite, de 1954 à 1956 il obtenu une bourse universitaire de la
"Fondation Educative Américaine Belge" de Bruxelles.
De 1956 à 1958 il fût étudiant à l'Université d'Edimboug en Ecosse. Il
gagna son doctorat en Archéologie Préhistorique début 1959, sous la
direction de Stuart Piggot, sur la période néolithique au Sud de la
Belgique. Il officia à Bonn au "Rheinisches Landesmuseum" début 1959,
jusqu'à sa retraite en 1991.
Depuis 1992, il se consacre au développement de logiciels pour
l'archéologie et officie en qualité de conférencier à l'université de
Cologne.
En 1971, il est nommé à la direction du département technique et
d'informatique appliquée à l'archéologie. |
 |
|
| |
Depuis 1980 il reste
conférencier à l'université de Cologne sur l'informatique appliquée à
l'archéologie. Début1989 il est nommée président honoraire de cette
discipline par l'Université. En 1999 il est récompensé par le prix
allemand de l'archéologie. Il est membre honoraire du groupe sur la
recherche archéologique aérienne de la Société Internationale de
Prospection Archéologique en 2004.
Il a à son actif plus de 120 articles scientifiques et 3 livres. |
|
| |
|
|
| |
 Otto BRAASCH :
un autodidacte devenu professeur.
Otto BRAASCH :
un autodidacte devenu professeur.
|
|
| |
Il est le tout premier archéologue
aérien européen. Depuis plus de vingt-cinq ans, Des airs, il a
photographié notre patrimoine historique commun. Bien qu'il soit
résolument orienté sur la période romaine, comme la plupart de ses
pairs, il a couvert toutes les périodes, du néolithique à l'époque
moderne.
Il aime voler avec tous, soit pour apprendre, soit pour faire partager
son immense savoir. Il a ainsi volé avec les grands archéologues anglais
Kenneth Saint Joseph, Jim Pickering et Derrick Riley. Il a initié de
nouveaux venus tels que Klaus Leidorf en allemagne et bien d'autres en
Tchéquie, Pologne ou Hongrie.
|
|
| |
 |
Il est l'auteur d'une
soixantaine de publications, articles, rapports ou chapitres de livres.
Son œuvre ne sert pas uniquement à modeler notre compréhension du passé
européen, elle aide aussi aux efforts entrepris par d'autres pour la
conservation de ce patrimoine. Il a reçu
en 2001 le prix de l'Héritage Archéologique Européen pour sa
contribution à l'archéologie aérienne. |
|
| |
 |
 |
|
| |
Un de ses clichés :
oppidum celtique en Allemagne |
|
|
| |
|
|
| |
 Roger AGACHE
Roger AGACHE |
|
|
| |
 |
Considéré comme le pionnier de
l'archéologie aérienne, Roger Agache est né à Amiens en 1926. Il est
docteur en histoire de l'Art et archéologie et correspondant de
l'Institut de France (Académie des inscriptions et belles lettres).
Conférencier et auteur de plus de deux cents publications dans des
périodiques scientifiques, ces travaux ont été salués par l'Académie des
inscriptions et belles lettres, le CNRS et l'Académie d'Architecture,
etc...
|
|
| |
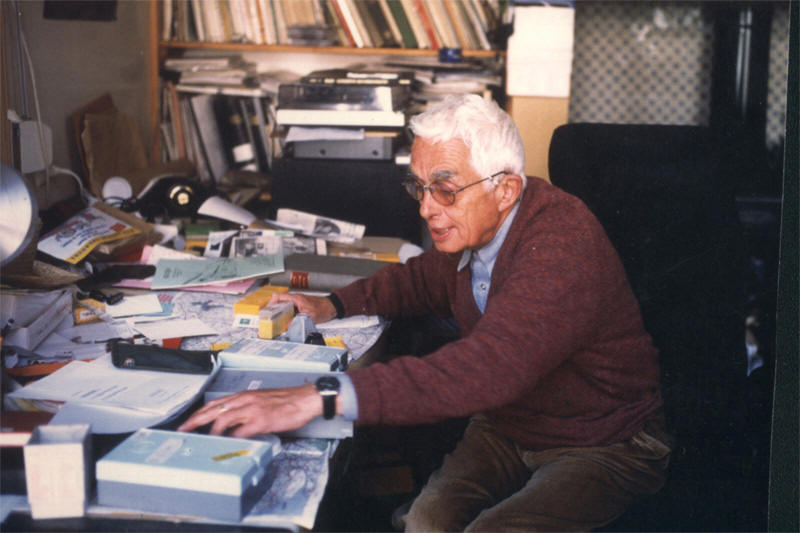 |
Un hommage tout
particulier lui a été rendu en 1999 lors du Colloque International
d’Archéologie aérienne dont les Actes lui ont été dédiés. |
|
| |
 |
Après de nombreuses
recherches sur le paléolithique et la néolithique, il a été Directeur
des Antiquités préhistoriques du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie,
puis chargé de cours à l’Université de Caen et chercheur au CNRS.
Il a obtenu le Grand Prix national d’Archéologie et de Géographie. |
|
| |
|
|
| |
 Raymond CHEVALLIER (1924 - 2004)
Raymond CHEVALLIER (1924 - 2004) |
|
| |
Né à Bourg-en-Bresse en 1929, dans
une famille d’instituteurs, il entra à l’École Normale
Supérieure de la rue d’Ulm en 1950. Brillamment reçu à
l’Agrégation de Lettres Classiques, puis diplômé de
l’École Pratique des Hautes Etudes, IVe Section, en
1955, il partit ensuite pour l’École Française de Rome
dont il fut membre de 1956 à 1958 et devint rapidement
l'un des spécialistes de l’Italie du Nord antique.
De retour en France, il exerça les fonctions d’Assistant
à la Sorbonne, de 1958 à 1962, puis de Maître-Assistant
à l’École Pratique des Hautes Études en 1963. Nommé
ensuite à la Faculté des Lettres de Tours, il y
accomplit le reste de sa carrière universitaire, d’abord
en tant que Chargé d’Enseignement, puis comme Professeur
des Universités, dirigeant pendant de longues années
l’Institut d’Études Latines de cet établissement.
|
|
| |
Il sut éveiller,
grâce à son exceptionnelle puissance de
travail et à son enthousiasme
communicatif, de nombreuses vocations de
latinistes et d’archéologues. On assiste
en nombre à ses cours, on le choisit
souvent ensuite comme directeur de
mémoire et de thèse, on recherche sa
présence dans les jurys de Doctorat. Ses
anciens étudiants gardent de lui un
souvenir très fort, en particulier tous
ceux de son "Séminaire de Topographie
historique et de Photo-interprétation,
de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes.
Ils cultivent la mémoire des heures
passées à l’écouter et reconnaissent
volontiers leur dette à son égard.
Son service militaire,
effectué dans l’Armée de
l’Air, lui avait révélé
l’intérêt de la
photographie aérienne
pour la recherche
archéologique et a fait
de lui un émule très
actif des grands
précurseurs dans ce
domaine, le Père
Poidebard et le colonel
Baradez. Sa carrière
dans le cadre de la
réserve l’a mené au
grade de colonel. Elle
lui a permit de se tenir
informé des plus récents
progrès de la technique
et d'en perfectionner
certaines applications,
telles que la détection
des traces de cadastres
antiques, de voies
romaines ou
d'agglomérations
disparues. Ce domaine de
recherche le conduisit,
de 1976 à 1980, à la
présidence de la Société
Française de
Photogrammétrie et
Télédétection.
|
 |
|
| |
|
Raymond Chevallier était un auteur
particulièrement fécond. Une cinquantaine d'ouvrages
traitent de ses thèmes favoris : les historiens romains,
l’Italie du Nord antique, la Gaule indépendante et
romaine, la photographie aérienne et ses applications
archéologiques, sans parler de plusieurs volumes de la
collection « Que sais-je ? » et d’une quantité élevée
d’ouvrages réalisés en collaboration. A ces livres
s’ajoutent des centaines d’articles, dans des
publications savantes françaises et étrangères dont
Archéologia. On a fait appel à lui d’autre part pour des
participations au Grand Larousse Encyclopédique, à l’Encyclopedia
Universalis, et à l’Encyclopédie de la Pléiade. Il a
réalisé plusieurs expositions photographiques sur
l’Antiquité, et à prononcé de multiples conférences tant
en France qu'à l’étranger. |
|
| |
|
|
| |
 Françoise CLAUSTRE
Françoise CLAUSTRE |
|
| |
|
|
| |
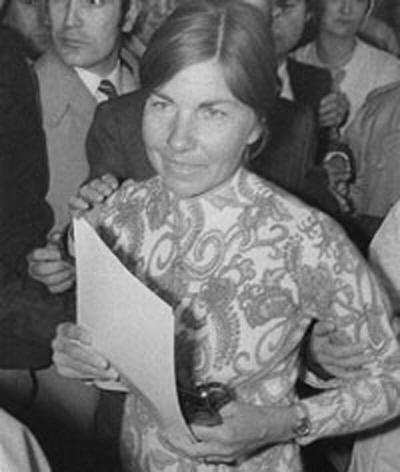 |
Françoise
Claustre. Anthropologue et archéologue. Née le 8 février 1937, décédée
le 3 septembre 2006, Cette femme est connue comme « la prisonnière du
désert » du 21 avril 1974 au 1er février 1977. Après sa
captivité, elle revint dans une région qu’elle aimait tant. Elle fut
intégrée au Centre Anthropologiques des Sociétés Rurales, prospectant
avec son époux, en tant que pilote, et Jean Vaquer comme naviguant.
Elle a laissé un travail remarquable et pourtant ignoré. Deux clichés de
son travail illustrent l’ouvrage d’Henri Delétang.
|
|
| |
 |
Magnifique
enceinte néolithique découverte à Cavanac (11) par Françoise Claustre.
Il s’agit d’un éperon au confluent de l’Aude et du Toron.
|
|
| |
|
|
| |
 Maurice MARSAC
Maurice MARSAC |
|
|
| |
Maurice Marsac est un archéologue
français né à Chavagné (79) en 1938 et mort dans la même ville en 1991.
Archéologue au Service régional de l’archéologie des Pays de La Loire,
au début des années 1960, encouragé par Roger Agache, précurseur de
l'archéologie aérienne en Picardie, Maurice Marsac développe ce procédé
de prospections archéologiques autour du Golfe des Pictons, actuel
Marais Poitevin. Ses travaux de recherches lui permettent de découvrir
un millier de sites archéologiques allant du néolithique à l’époque
moderne. Il innove et applique des techniques comme la photographie
infrarouge.
|
|
| |
 |
Fort d’une décennie de
recherches, en 1975, il soutient une thèse à l’École des hautes études
en sciences sociales intitulée Inventaire archéologique par
photographie aérienne des abords du Golfe des Pictons. |
|
| |
 |
Parallèlement, il
écrit de nombreux articles publiés en France et à l’étranger, participe
à des colloques et mène des fouilles archéologiques sur des sites
gallo-romains notamment à La Fougeoire (La Crèche) de 1965 à 1969, à
Saziré (commune d’Aiffres) au début des années 1970. L’Inventaire
archéologique par photographie aérienne des abords du Golfe des Pictons,
constitué de trois tomes (1991, 1993 et 1996), a été publié à titre
posthume sous l'impulsion de sa mère, Mme Talbot-Marsac. |
|
| |
A ma connaissance, c'est le seul
archéologue qui, grâce à des relations personnelles au sein de la base
aérienne de Mont-de-Marsan, a pu obtenir des clichés aériens pris à
partir de Mirages IV-P supersoniques de l'Armée de l'Air. |
|
| |
|
|
| |
 Daniel JALMAIN
Daniel JALMAIN
|
|
|
| |
Daniel Jalmain,
prospecteur pour l'île de France et l'Eure-et-Loir. Archéologue
bénévole, directeur
de collège.
De belles découvertes sont à porter à son actif, dans une large palette
chronologique. Homme discret et efficace, un des tous
premiers. |
|
| |
 |
En 1970, il a présenté
au Colloque International sur la Cartographie Archéologique (organisé
par R. Chevallier) les résultats de ses investigations sur les voies
entre Seine et Loire. Il citait comme une évidence indiscutable
l'existence d'une lieue gauloise de 2 450 mètres sur les axes Ablis-Blois
et Sens-Chartres. |
|
| |
Sa thèse de troisième cycle, à
l'Ecole Pratique des Hautes Etudes, 6ème section, a été publiée chez
Technip, sous le titre "Archéologie aérienne en Ile-de-France" en 1970.
Edition pratiquement épuisée à l'heure actuelle. |
|
| |
|
| |
 René GOGUEY
René GOGUEY |
|
| |
Pilote-archéologue, René Goguey
est diplômé de l'Ecole Pratique desHautes Etudes (Thèse : de l'aviation
à l'archéologie, Paris, 1968),
UMR 5594 du CNRS "Bourgogne du premier millénaire", Université de
Bourgogne,
Lieutenant-colonel de l'Armée de l'Air (33ème escadre de
reconnaissance),
Pilote spécialisé en archéologie, poursuit depuis bientôt 50 ans ses
programmes annuels de recherche, malgré le "crash" de 1983.
Membre résident de l'Académie des Sciences, Arts et Belle Lettres de
Dijon,
Président du Comité Régional de la Recherche Archéologique de Bourgogne.
|
| |
 |
René
Goguey devant un MH Broussard, avant un survol sur Alésia. |
| |

|
Q Plus de 3 000 heures de vol (dont 1 800
à bord du R 3000 du Conseil Régional de Bourgogne, ci-contre)
Q 75 000 photographies
Q 4 000 sites enregistrés
|
| |
Ses travaux d'archéologie aérienne se résument à trois périodes :
Première période : dans le cadre de l'Armée de l'Air, avec les
avions de la BA de Dijon Longvic et ceux de la 33ème Escadre de
reconnaissance à Strasbourg. Recherches ininterrompues depuis les
premières expériences réalisées en 1958 (Sanctuaire gallo-romain d'Essarois).
Mise au point d'une méthodologie sur le site d'Alésia. Extension de la
recherche à l'ensemble de la Bourgogne, avec la découverte de villas
gallo-romaines,de nécropoles proto-historiques (Longvic), de nombreux
plans sur les grands sites de Vix, Alésia, Mirebeau, Les Bolards.
Seconde période : à bord d'avions civils de l'Aéroclub de la Côte
d'Or, dans le cadre de la recherche subventionnée par la Direction des
Antiquités de Bourgogne et du cconseil Général de la Côte d'Or.
Extension des recherches sur un programme "De la Loire au Rhin". De
multiples découvertes avec, en particulier, les photographies
spectaculaires de 1976, le "second théâtre d'Autun" et les
théâtres de Mâlain, d'Entrains, les sanctuaires de Vertault, d'Entrains,
de Saint-Usage, les villas de Nicey, de Griselles et d'Argilly, les
mottes castrales de Magny-sur-Tille, d'Orgeux, de Montigny-sur-Aube...
Troisième période : à bord de l'avion Robin 3000 acquis en 1990
par le Conseil Régional de Bourgogne. Recherche dynamisée par
l'utilisation d'un avion spécialement adapté à la photographie aérienne
- exemple : les découvertes d'une extrême précision (jusqu'aux points
des trous de poteaux des tours de bois) sur le siège d'Alésia. Programme
de prospection-inventaire dans le cadre de la "carte archéologique"
établie par le Service Régional des Antiquités de Bourgogne. Missions
"relations internationales" sur l'Europe de l'Est : en Tchécoslovaquie
(1991) et en Hongrie (1993 à 2000). Missions officialisées de 1995
à 1998 par le Ministère des Affaires Etrangères. Nombreuses découvertes
dans la vallée du Danube et dans la grande plaine hongroise jusqu'à
l'Ukraine.
|
| |
Archéologie de terrain à
partir du dossier des photos aériennes
:
Direction des fouilles sur la nécropole protohistorique à épée de bronze de Longvic
(1964-1965)
Direction des fouilles sur la villa romano-celtique de Rouvres-en-Plaine
(1966-1967)
Direction des fouilles sur le camp militaire de la VIIIème Légion Romaine
à Mirebeau (1968-1990)
Direction des fouilles sur le sanctuaire celtique et gallo-romain de
Mirebeau (1977-1981)
Campagnes de sondages sur la villa portuaire de Luy
|
| |
 |
Restes du DR 400
lors d'un crash. Il s'agit d'un atterrissage impromptu suite à une panne
moteur : rupture de vilebrequin, hélice arrachée en vol, incendie moteur
en vol, posé en catastrophe dans une prairie, course achevée dans une
haie, aile arrachée mais pas d'incendie. Après deux jours de clinique,
pour examens médicaux, le pilote redécollait mais sans son co-pilote qui
n'a plus jamais mis les pieds dans un avion de tourisme. Le cliché n'est
pas très net, ayant été pris par un paysan possédant un appareil
photographique jetable, venant au secours de l'équipage qui était
fortement "sonné". |
| |
Diffusion de la recherche
:
Expositions "grand public" : en particulier aérodrome de Beaune (1979),
Amiens (1992), Budapest (1995), Musée de Bibracte (1996), de Prague
(1996), Musée de Chatillon-sur-Seine (1997).
Participation (à titre de conférencier) aux colloques internationaux de
Paris (1964), de Londres (1974), d'Amsterdam (1982), de Bruxelles (1982
et 1986), de Lattes-Montpellier (1992), de Berlin (1994), d'Oxford
(1995), de Budapest (1995), de Prague (1997), du Collegium de Budapest
(1998).
Publications multiples à l'échelon régional, national et international
(65 titres).
Reportages, interviews, réalisation de films, en particulier :
"l'archéologie vue du ciel" FR3 national, 1983, "Alésia vu du ciel : l'oeil
de René Goguey", prix du meilleur film d'archéologie métropolitaine,
Festival International d'Amiens, 2005.
CD-Rom : "L'histoire vue du ciel" (Centre Européen du Mont-Beuvray), "Le
siège d'Alésia", 141 photos aériennes interprètées (publication sous la direction de Michel Reddé,
Académie des Inscriptions de Belles Lettres, 3 volumes).
|
| |
|
| |
 Jean ROISEUX
Jean ROISEUX |
| |
Jean Roiseux est membre de
l'Association A.R.E.A avec Fracine Marcoult et Laurent Bourgeno.
La région prospectée se situe à l'extrémité sud-est de la Brie
champenoise. Il est limité au Nord par le tracé de la N4, au Sud par la
Seine, à l'Ouest par une ligne passant de Jouy-le-Châtel à
Donnemarie-Dontilly et à l'Est par les limites départementales de l'Aube
et de la Marne. De plus, il faut y rajouter une micro-région : le
Montois qui correspond à deux cantons dans leur totalité (Provins et
Villers-Saint-Georges) et à trois autres en partie intégrés
(Bray-sur-Seine, Donnemarie-Dontilly et Nangis).
|
| |
. |
Jean Roiseux prospecte
en Ultra Léger Motorisé en partant de Voulton (5 kilomètres au Nord de
Provins). La confiance en son pilote est évidemment primordiale.
Celui-ci, Laurent Bourgeno, est habitué aux impératifs de la prise de
vue archéologique et repère également des sites.
Deux types de mission sont réalisées : l'une à partir de renseignements
historiques ou des résultats des prospections au sol et l'autre en vol
libre en effectuant des bandes de plusieurs kilomètres de long. |
| |
Les axes de recherche de l'équipe sont les suivants :
L'habitat fortifié avec les mottes et les maisons fortes.
Toutes les fermes de la région du Montois ont été photographiées et il
s'est avéré, après recherches en archives, que 60% d'entre-elles étaient
médiévales.
Autour de l'argile : dans la commune de Savins, des fours
de tuiliers des IIème et IIIème siècles après J.C. sont encours de
fouille. Ce site, à proximité de la voir gallo-romaine dite "le Perré",
a d'abord été prospectée au sol, puis en aérien avant d'être étudié. Les
clichés aériens présentés font apparaître des saignées dans le bois, à
proximité du site et correspondent aux fosses d'extraction de l'argile.
La seigneurie de Flaix :c'est un travail documentaire qui
a débuté à partir d'une carte du XVIème siécle. Cette zone a été ensuite
reportée sur une carte I.G.N. au 1/25 000ème, puis des prospections
sytématiques, au sol et en aérien, ont complété cette étude.
Etude des vestiges de bois : les tâches sombres qui se
détachent dans le champs correspondent à la déforestation, aux brûlis.
C'est ce que l'on appelle des "lunes de déforestation". des comparaisons
sont faites avec des cartes anciennes pour tenter une restitution de
l'évolution du paysage. cette région aété peu aménagée et le paysage est
encore assez conforme à ce qu'il devait être ) l'époque médiévale.
|
| |
|
| |
 Louis MONGUILAN
Louis MONGUILAN
|
| |
 |
Louis Monguilan.
Jeune résistant, il fut arrêté par la Gestapo, sur dénonciation le 20
octobre en 1943. Envoyé en déportation au camp de Mathausen, il a
miraculeusement survécu étant arrivé à la plus extrême limite de
résistance vitale (35 kg à sa libération). En 1948, jeune militaire, il
est breveté parachutiste. Il est versé à sa demande dans l'ALAT
(Aviation Légère de l'armée de l'Air) ou il a obtenu son brevet
d’observateur-pilote d’avion et d’hélicoptère le 1er août
1956. Le colonel Monguilan totalise actuellement plus de 8 000 heures de
vol. En octobre 1976, Louis Monguilan a soutenu une thèse de Doctorat es
Science à l'Université de Provence sous la direction du professeur
Chevallier sur le sujet de l'archéologie aérienne : "Observation
et proposition d'interprétation". Pour ajouter une corde à son
arc, Louis Monguilan est aussi plongeur sous-marin. A notre
connaissance, il est le seul pilote-plongeur archéologue. Il a mis au
jour près de Fos, une grande nécropole romaine ainsi qu’un port
antique.
|
| |
|
| |
 Charles LEVA, Henri DELETANG et Michel DRILEN
Charles LEVA, Henri DELETANG et Michel DRILEN
|
| |
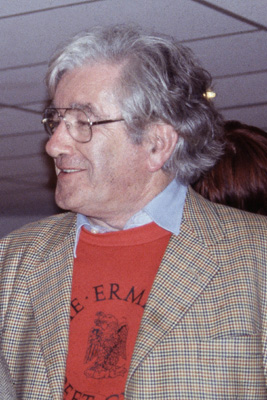 |
Charles LEVA,
archéologue belge, en 1995. Il commença ses prospections en 1964 en
mettant au point cette méthode de prospection alors inexistante en
Belgique. Ces recherches portèrent sur les voies romaines. Cet homme de
grand talent n’imaginait la recherche que sous forme collective avec
interaction entre observateur, pilote, photographe, historien etc…. Il
créa en 1978 une association sans but lucratif : le Centre
Interdisciplinaire de Recherches Aériennes (Cira) à Bruxelles. Il
noua des contacts fructueux avec Roger Agache, Henri Deletang, René
Goguey.
|
| |
 |
Charles
LEVA à Abbeville avec Roger Agache en 1981 |
| |
 |
Henri Delétang (à
gauche) avec Michel DRILLEN, pilote belge de la CIRA ( centre d'étude
créer par Charles LÉVA, fameux archéologue aérien belge). Le cliché fut
pris par Jacques DUBOIS, sur l'aérodrome de Romorantin-Grièves Pruniers
en 1994. Henri est Professeur de Collège en Histoire et Géographie. En
1974, il a commencé l’archéologie terrestre en conduisant les fouilles
programmées sur le théâtre gallo-romain de Neung-sur-Beuvron ainsi que
par voie aérienne. Il a découvert environ un millier de sites, pris près
de 15 000 clichés et est l’auteur, entre autres, de deux ouvrages
remarquables cités en bibliographie. En 1979, il a fondé et anime
toujours, le Groupe de Recherches Archéologiques et Historiques de
Sologne. |
| |
|
| |
 Maurice GAUTHIER
Maurice GAUTHIER
|
| |
 |
Maurice Gauthier.
Professeur des écoles. Archéologue aérien bénévole, débutant la
prospection aérienne en 1985 (né en 1952). Il est considéré comme
l'archéologue aérien le plus prolifique de Bretagne survolant quatre
départements : le Morbihan, les Côtes-d’Armor, l'Ille-et-Vilaine et le
Finistère. Environ 2000 sites découverts en 800 heures de vol.
Responsable d'un programme de prospection-inventaire en Bretagne
centrale depuis 1985. Titulaire d'un D.E.A. Histoire et Civilisations.
Thèse de doctorat en cours :le Porhoët pré-romain et gallo-romain,
d'après la photographie aérienne. |
| |
|
| |
 Marc LANGLOIS et Pascal LAFOREST
Marc LANGLOIS et Pascal LAFOREST
|
| |
 |
Marc
LANGLOIS (à gauche) et Pascal LAFOREST, archéologues du Service
départemental des Yvelines. Ces prospecteurs utilisent un DR 400 basé
sur l’aérodrome de St-Cyr l’Ecole. Ils commencèrent leurs prospections
systématiques du département en 1987. 329 sites ont été photographiés à
ce jour (2006). |
| |
|
| |
 François BESSE
François BESSE
|
| |
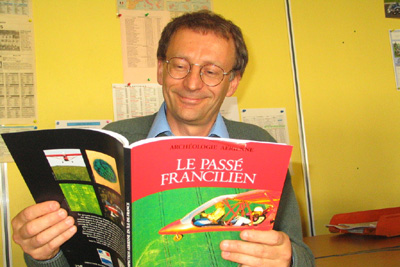 |
François Besse.
300 sites. 300 heures de vol pour l’archéologie. Né en 1959. Prospecte
particulièrement l’Essonne depuis 1991. Ses aérodromes d’attache sont
Cernay-la Ferté-Allais et Etampes. Surnommé, par certains de ses
collègues : le Buster Keaton de l’archéologie française, en vérité il
apparaît que c'est un garçon plein d’humour, la preuve lisant l’ouvrage
dont il fut la cheville ouvrière.
|
| |
 |
L’avion
qu'utilise François Besse, Robin DR 360, avec silencieux, immatriculé
F-BSBZ |
| |
|
| |
 Patrick F. JOY
Patrick F. JOY |
| |
Né le 13 mars 1947, ingénieur en Galvano-Chimie et Environnement et directeur de la société
S.E.R.T.S spécialisée en électrochimie, analyse des eaux et des sols,
problèmes de métaux lourds dans l'environnement.
Q Archéologue bénévole depuis 1975
Q Pilote privé depuis 1988
Q Guide conférencier au Musée de l'Air du
Bourget depuis 1999.
|
| |

© Besse F. |
1 300 heures de vol,
1 900 sites photographiés,
fond de 15 000 clichés diapositives |
| |
|
| |
Texte et
publications (renvoi vers rubrique
Conférence -> textes & publications) |
| |
 Bibliographie sommaire
Bibliographie sommaire |
| |
|
| |
 Bernard LAMBOT
Bernard LAMBOT |
| |
Bernard
Lambot est un archéologue que j’apprécie particulièrement. Pourquoi :
parce qu’il est resté bénévole depuis l’âge de 14 ans (il en a une
soixantaine à cette date du 13 mars 2009). Il a fouillé avec les plus
grands, il a co-publié avec les mêmes, il a découvert le passé de la
Champagne et des Ardennes et il est attaché au CNRS (en tant que
bénévole). Et puis, il est l’inventeur et le Directeur des fouilles d’Acy-Romance,
ayant mis au jour des inhumations gauloises très particulières (corps
assis - offrande chtonienne - ayant fait sourire à l’époque quelques
sommités archéologiques, mais le sujet s’avère depuis de plus en plus
d’actualité, de nombreuses fouilles de Suisse en Charente accréditant
cette coutumes fort mal connue).
|
| |
 |
A ce
jour, le phénomène a 1 500 heures de vol, 1000 sites découverts, et
24 000 clichés diapositives. Il a longtemps volé avec Olivier Potier de
l’A.C. du Rethelois. Son pilote actuel, à droite du cliché, se nomme
Albert Moureau. |
| |
|
| |
 |
Pour
préparer sa retraite, il s’est remis à ses amours d’adolescent : la
peinture (tout en continuant l’archéologie). Je conseille à tout lecteur
de feuilleter Cartes postales aériennes de Champagne-Ardennes ;
AAREA, 1996,
livre remarquable où tout est expliqué. De plus, cher lecteur, comme
vous avez Internet, posez les questions sur Goggle : Bernard Lambot, ou
bien fouilles d’Acy-Romance.
|
| |
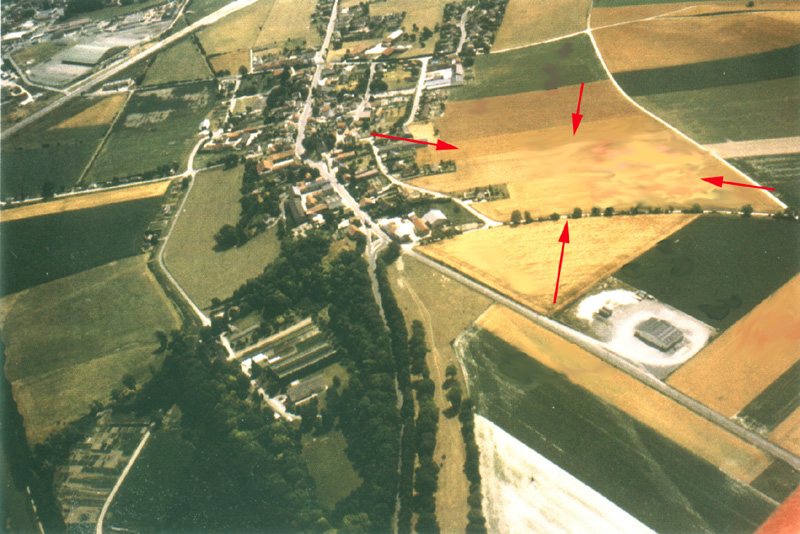 |
Cliché aérien d'Acy/Romance. Les flèches
délimitent le périmètre du site. |
| |
 |
Fouille in-situ, à Acy-Romance
:
exemple type d'offrande chtonienne, coutume marginale et encore mal
connue. |
| |
 |
Reconstitution en 3 dimensions par
Bernard Lambot de ce procédé d'offrande à partir de la photo précèdante. |
| |
|
| |
 François VASSELLE
François VASSELLE |
| |
François Vasselle est un
archéologue aérien trop peu connu pour ne pas figurer dans notre
inventaire. Nous avons découvert ces travaux dès 1977 dans le bulletin
du Centre de Recherches Archéologiques du Vexin Français. Comme beaucoup
de prospecteurs aériens, notre collègue est un passionné et bénévole de
l'archéologie. Né en 1924, il a commencé à voler et à photographier en
1962, initié par Roger Agache, son contemporain et camarade de lycée.
Pour des raisons familiales, il volait surtout dans l'est du département
de la Somme avec Huchez comme pilote, basé à Mondidier. Le fait d'être
architecte D.P.L.G. motivait sa passion de découvertes enfouies sous le
sol. Après des premiers résultats encourageant, les Directeurs de
Antiquités Historiques Jean-Michel Desbordes puis Jean-Claude Blanchet
lui conseillèrent de survoler le Plateau picard dans l'Oise entre
Breteuil et Chaumont-en-Vexin.
|
| |
 |
Dans cette région, les fondations
des bâtiments gallo-romains étaient constituées de silex, peu visibles
d'avion, alors que dans la Somme, elles étaient en craie très visibles
sur la terre arable. Vers 1965, les sous-solages et les labours profonds
après les remembrements donnèrent des images remarquables. Comme
beaucoup "d'anciens", 1976 à marqué notre collègue en raison de la
sécheresse exceptionnelle. |
| |
 |
Bel ensemble
fossoyé, probablement une grande ferme indigène datant de la Tène
finale, découvert à Bailleul-sur-Thérain, au lieu-dit la Houssière.
|
| |
 |
Bel enclos indigène avec une porte
en forme de pince, découverte à Monsures (80), au lieu-dit le
Martillois en 1998.
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
 |